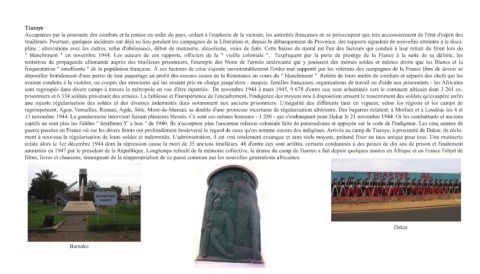Page 47 - Force Noire
P. 47
Catalogue Force Noire 64p 30/07/07 10:41 Page 45
e
o
y
a
i
T Tiaroye
r
Accaparées par la poursuite des combats et la remise en ordre du pays, cédant à l'euphorie de la victoire, les autorités françaises ne se préoccupent que très accessoirement de l'état d'esprit des
tirailleurs. Pourtant, quelques incidents ont déjà eu lieu pendant les campagnes de la Libération et, depuis le débarquement de Provence, des rapports signalent de nouvelles atteintes à la disci-
pline : altercations avec les cadres, refus d'obéissance, début de mutinerie, alcoolisme, voies de faits. Cette baisse du moral est l'un des facteurs qui conduit à leur retrait du front lors du
" blanchiment " en novembre 1944. Les auteurs de ces rapports, officiers de la " vieille coloniale ", l'expliquent par la perte de prestige de la France à la suite de sa défaite, les
tentatives de propagande allemande auprès des tirailleurs prisonniers, l'exemple des Noirs de l'armée américaine qui y jouissent des mêmes soldes et mêmes droits que les Blancs et la
fréquentation " émolliente " de la population française. À ces facteurs de crise s'ajoute incontestablement l'ordre mal supporté par les vétérans des campagnes de la France libre de devoir se
dépouiller brutalement d'une partie de leur paquetage au profit des recrues issues de la Résistance au cours du " blanchiment ". Retirés de leurs unités de combats et séparés des chefs qui les
avaient conduits à la victoire, ou coupés des structures qui les avaient pris en charge jusqu'alors - maquis, familles françaises, organisations de travail ou d'aide aux prisonniers - les Africains
sont regroupés dans divers camps à travers la métropole en vue d'être rapatriés. De novembre 1944 à mars 1945, 9 678 d'entre eux sont acheminés vers le continent africain dont 3 261 ex-
prisonniers et 6 334 soldats provenant des armées. La faiblesse et l'inexpérience de l'encadrement, l'indigence des moyens mis à disposition attisent le ressentiment des soldats qu'exaspère enfin
une injuste régularisation des soldes et des diverses indemnités dues notamment aux anciens prisonniers. L'inégalité des différents taux en vigueur, selon les régions et les camps de
regroupement, Agen, Versailles, Rennes, Agde, Sète, Mont-de-Marsan, se double d'une promesse incertaine de régularisation ultérieure. Des bagarres éclatent, à Morlaix et à Loudéac les 4 et
11 novembre 1944. La gendarmerie intervient faisant plusieurs blessés. Ce sont ces mêmes hommes - 1 280 - qui s'embarquent pour Dakar le 21 novembre 1944. Or les combattants et anciens
captifs ne sont plus les fidèles " tirailleurs Y' a bon " de 1940. Ils n'acceptent plus l'ancienne relation coloniale faite de paternalisme et appuyée sur le code de l'indigénat. Les cinq années de
guerre passées en France où sur les divers fronts ont profondément bouleversé le regard de ceux qu'on nomme encore des indigènes. Arrivés au camp de Tiaroye, à proximité de Dakar, ils récla-
ment à nouveau la régularisation de leurs soldes et indemnités. L'administration, il est vrai totalement exsangue et sans réels moyens, prétend fixer un taux unique pour tous. Une mutinerie
éclate alors le 1er décembre 1944 dont la répression cause la mort de 35 anciens tirailleurs. 48 d'entre eux sont arrêtés, certains condamnés à des peines de dix ans de prison et finalement
amnistiés en 1947 par le président de la République. Longtemps refoulé de la mémoire collective, le drame du camp de Tiaroye a fait depuis quelques années en Afrique et en France l'objet de
films, livres et chansons, témoignant de la réappropriation de ce passé commun par les nouvelles générations africaines.
Dakar
Bamako